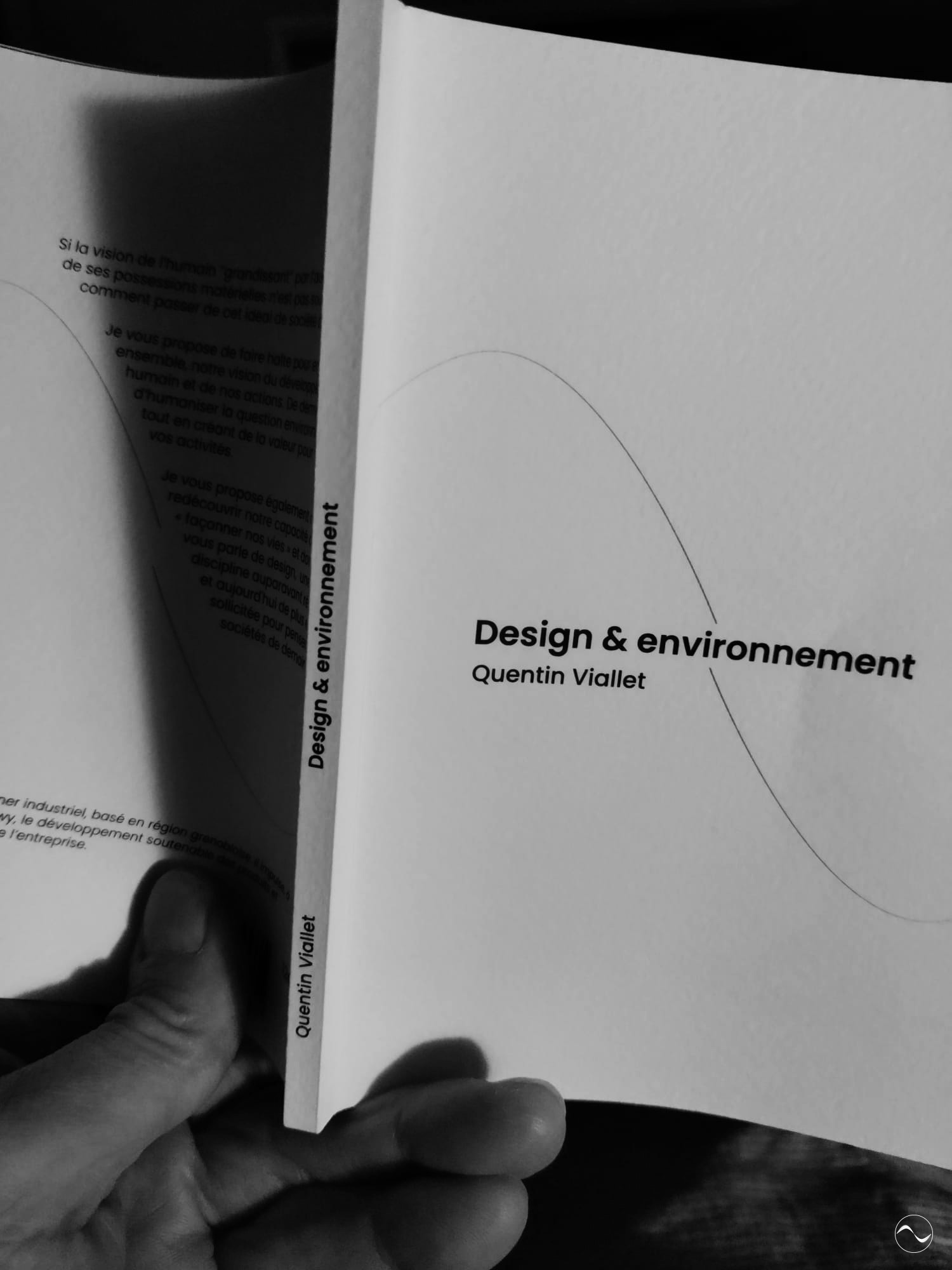Créativité, créativité, créativité…
Pour trouver de l’inspiration !
Est-ce indispensable pour un peintre de s’intéresser aux travaux des autres peintres pour s’inspirer ? Est-ce nécessaire que l’influence soit directe ?
Bon nombre d’exemples nous rappellent que ce qui nous inspire ne nous vient pas forcément de nos pairs ou d’activités similaires aux nôtres. Dans le monde du design, c’est ce que nous désignons comme des milieux afférents : qui touche à, relatif à. Et on aime bien aller jeter un œil dans des milieux qui a priori, n’ont rien à voir avec le sujet initial.
Le pompon, c’est que souvent, cela donne des réponses absolument canons.
Pour trouver de l’inspiration, il ne faut pas hésiter à aller chercher dans d’autres domaines que le sien. Et pour faire ça, rien de mieux qu’une bonne question, une bonne problématique. Identifier le problème et le reformuler pour s’offrir tout un univers d’inspiration.